

Semaine du jeudi 14 octobre
2004 - n°2084 - France
«On peut faire des études, on reste un Arabe dans la réalité sociale»
SOS «minorités visibles»!
Faut-il instaurer des règles de discrimination positive pour assurer «la
diversité» dans l’économie et l’administration? Le débat est lancé. Mais déjà
on crée une Haute Autorité antidiscrimination et on parle de traduire les
«discriminateurs» en justice...
France, société coloniale! C’est le miroir terrible que
tend à son pays un enfant chéri de l’élite, l’industriel Yazid Sabeg, dans un
livre de combat (1). France, société coloniale, où le sort fait aux enfants
d’immigrés décalquerait la situation des «indigènes musulmans» dans l’Algérie
de papa. Des sous-citoyens de fait, rebondissant sur un mur invisible,
laissés en marge des postes de commandement, des emplois valorisants: «On
peut faire des études, on reste un Arabe dans le regard des gens et dans la
réalité sociale.» Sabeg serait un gauchiste, un révolté professionnel, sa
charge laisserait indifférent. Mais le provocateur est un grand patron,
souriant, courtois: un homme des beaux quartiers, maniant le discours des
dominants et possédant leurs codes. Président de la Compagnie des Signaux,
vendeur de technologies de renseignement, proche des hiérarques démocrates-chrétiens
et chiraquiens, Jean-Louis Borloo l’a nommé à la tête de l’Agence nationale
pour la Rénovation urbaine, un des outils du plan de cohésion sociale. C’est
adossé à sa réussite que Sabeg provoque la France. Il lui crie qu’elle n’est
pas ce qu’elle prétend être, que son surmoi républicain est un leurre, que
ses principes égalitaires l’empêchent de voir le mal. Et il réclame un
traitement de choc. Des politiques de discrimination positive, comme aux
Etats-Unis, pour redonner leur chance à ceux qui la méritent: ces Français
moins blancs et moins égaux que les autres.
S’il enfreint l’omer-ta bien-pensante, Sabeg va relancer un débat brûlant.
Tabou des mots, sexe des anges, principes républicains. «Dans ce pays,
personne n’ose employer le mot "arabe", ou "maghrébin",
constate Patrick Simon, chercheur à l’Institut national d’Etudes
démographiques. C’est pourtant bien de cela qu’il s’agit. On édulcore la
réalité en évoquant les "jeunes des quartiers", les "cités
difficiles". Mais on ne pourra pas s’échapper indéfiniment.» A force de
rapports et de missions d’enquête, on appréhende une réalité dévastatrice:
Les «immigrés ou perçus comme tels», selon la jolie expression de la
sociologue Mouna Viprey, sont plus souvent au chômage, moins souvent recrutés
à diplôme égal, moins souvent convoqués par les recruteurs. Diplômés de
l’université restant en rade. Lycéens de l’enseignement professionnel dont
les profs valident les diplômes sans le stage obligatoire parce qu’aucune
entreprise n’a voulu d’eux. Candidats locataires maghrébins ou noirs retoqués
par le racisme de propriétaires, ou les quotas sournois d’organismes HLM.
La conséquence politique est terrible: la naissance d’une véritable
«question arabe» – en attendant une «question noire» – qui empoisonne le
pays. Communautaristes, caïds de quartiers, islamistes aux langues de
velours, prospèrent sur les discriminations. L’an dernier, l’ancien ministre
Bernard Stasi demandait à l’Etat d’accompagner sa politique de ferme laïcité
d’une action vigoureuse contre les discriminations. Seule manière de rester
crédible et de ne pas ajouter chez les Français d’origine ostentatoire le
sentiment d’être stigmatisés. Stasi sera bientôt nommé à la tête d’une Haute
Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité – la Halde –
prolongeant l’action lancée sous le gouvernement Jospin. Tout se passe comme
si les élites de ce pays réagissaient enfin, dans l’urgence et le désordre,
devant la catastrophe prévisible.
«La discrimination ruine la cohésion nationale», a proclamé Jacques Chirac,
qui réclame – sans oser, comme Sarkozy, le mot de discrimination positive –
des politiques de recrutement volontaristes pour les minorités. Le ministère
de l’Intérieur a lancé un programme, les «cadets de la République», visant à
faire recruter des «jeunes des quartiers» dans l’administration. Une centaine
de nouveaux gardiens de la paix ont ainsi fait leurs premières armes cette
année. On reprend une idée des années 1990: faire ressembler les services
publics à la population. La méthode s’inspire aussi des expériences de
Sciences-Po Paris, qui est allée recruter des bons élèves venus des ZEP.
Méthode douce, volontarisme valorisant? C’est le choix de ces entrepreneurs
qui revendiquent une «charte de la diversité». Un engagement à ne plus
oublier les «minorités visibles», selon le mot à la mode. La «diversité»,
semble avoir été inventée par des hommes de marketing. Un concept caressant
et positif. Il permet d’introduire cette notion ethnique que la morale
républicaine réprouve. Il s’adresse à l’esprit d’entreprise des patrons. «Ne
vous privez pas de l’énergie des minoritaires», lance Sabeg à ses collègues
patrons. L’homme sait doser accusation et incitation. Il anime, avec Claude
Bébéar, ce lobby prodiversité, arc-bouté au libéral Institut Montaigne (2) où
l’on croit plus au volontarisme entrepreneurial qu’en l’action étatique pour
transformer la société.
L’objectif de la diversité a pourtant l’inconvénient de ne pas aller jusqu’au
bout du problème. «On peut pratiquer la diversité tout en restant
discriminatoire», constate Samuel Thomas, vice-président de SOS-Racisme. Il
garde dans ses fichiers le cas de cette entreprise d’hôtesses, qui embauche
Asiatiques, Beurettes, Noires et Blanches, mais réserve certains postes,
certaines missions, aux seules «Blanche-Neige» de son staff. Thomas est un
républicain pur jus. A la diversité, il préfère l’égalité. Il pense encore
que la France peut être color-blind, ignorer totalement les origines des
gens, à condition de s’en donner les moyens. «La société est déjà métissée,
affirme-t-il. Elle est prête à suivre des politiques qui affronteraient les
discriminations.»
Depuis plus de cinq ans, SOS-Racisme a orienté l’essentiel de ses forces sur
les luttes antidiscrimination. Le «testing», ce piège tendu aux racistes par
les militants des Potes, a été reconnu en 2002 comme une arme juridique
valide par la Cour de Cassation. Discrimination à l’embauche, au logement, à
l’entrée des boîtes... «On disait toujours qu’il était impossible de prouver
les discriminations en justice. C’est faux. On peut. Si on le veut. Si on met
les services publics en marche. La police, la justice doivent être mises au
service de cette cause... La discrimination est un délit pénal, elle doit
être prise comme telle!»
Une République qui retrouverait ses bases? Thomas regrette qu’elle ait
renoncé à faire appliquer ses principes – y compris dans ses institutions. Il
dénonce le tri ethnique à la prison de la Santé, ces cellules pour Noirs,
pour Blancs, pour beurs, que l’administration tolère. Et la capacité de
l’Etat et des grandes institutions à se protéger: «On arrive à faire
condamner des petits patrons, des petits commerçants. Mais quand on touche
aux grands, il y a un blocage.» Depuis plusieurs années (voir encadré),
Thomas pourchasse des sociétés HLM qui pratiquent le tri ethnique de leurs
appartements et de leurs locataires, au nom de l’équilibre social des cités.
La justice est restée désespérément passive. «La discrimination, ce ne sont
pas seulement quelques méchants racistes, des beaufs lepénistes que l’on
pourrait stigmatiser, dit Patrick Simon. C’est tout le monde. C’est un mal de
notre société. C’est quelque chose qui se pratique, parfois, malgré des
bonnes volontés apparentes. Pour voir où le système bloque, il faut se donner
des outils pour comprendre, aller voir les entreprises, les cabinets de
recrutement, pratiquer des audits.»
Cette compréhension est un des enjeux de la Halde, tellement attendue. On lui
prête de grandes espérances. Mais ses premiers pas, la semaine dernière, à
l’Assemblée nationale, lors du débat en première lecture de sa création, ont
inquiété certains de ses partisans. Déception devant un hémicycle déserté par
des élus indifférents, en dépit de leurs proclamations médiatiques.
Etonnement face aux représentants de la gauche intervenant, de manière
obsessionnelle, sur une seule question: celle de l’homophobie, ou des
discriminations envers les transsexuels.
Comme si cette question, plus urbaine, moderne, «bobo», avait masqué les
discriminations raciales. La Haute Autorité – contrairement aux dispositifs
inventés sous la gauche – prendra en effet en charge toutes les
discriminations. Femmes, homosexuels, handicapés pourront se tourner vers
elle. La question du racisme risque de s’y diluer. «La discrimination
ethnique est le sujet le plus grave pour notre pays, je ne l’oublie pas»,
affirme Stasi. Mais la volonté du vieux combattant pourra ne pas suffire face
aux pressions de tant de lobbies de victimes potentielles. Autre danger: une
culture de la Halde trop apaisante, trop axée sur la médiation, l’arrangement
au cas par cas. Stasi, homme de bonne volonté, ancien médiateur de la
République, croit que les gens peuvent s’amender et que le dialogue peut
résoudre les souffrances. SOS-Racisme s’inquiète d’une «dépénalisation des
discriminations ». Sabeg soupire contre la mollesse supposée de Stasi. «La
médiation permet de résoudre les cas individuels, dit Patrick Simon. Mais
elle ne fera jamais progresser la société.» A l’Assemblée, les députés ont
rectifié un article tendancieux, qui mettait la médiation au premier rang des
missions de la Halde. «Pour nous, les choses sont claires, affirme Catherine
Vautrin, secrétaire d’Etat à l’Intégration et à l’Egalité des chances,
marraine et supportrice de la Halde. La Haute Autorité devra accompagner les
gens en justice. Elle devra débusquer des affaires de discrimination, aller
chercher les cas. Elle servira à monter des dossiers, pour faire condamner
les fautifs. Le gouvernement croit en la valeur d’exemple des condamnations...»
Mais la peur du gendarme sera-t-elle suffisante pour chasser les fantômes des
colonies?
(1) «Discrimination positive. Pourquoi la France ne peut y échapper»,
Yazid et Yacine Sabeg, Calmann-Lévy.
(2) Voir aussi «Ni quotas, ni indifférence, l’entreprise et l’égalité
positive», Laurent Blinet, rapport à l’Institut Montaigne.
Claude Askolovitch


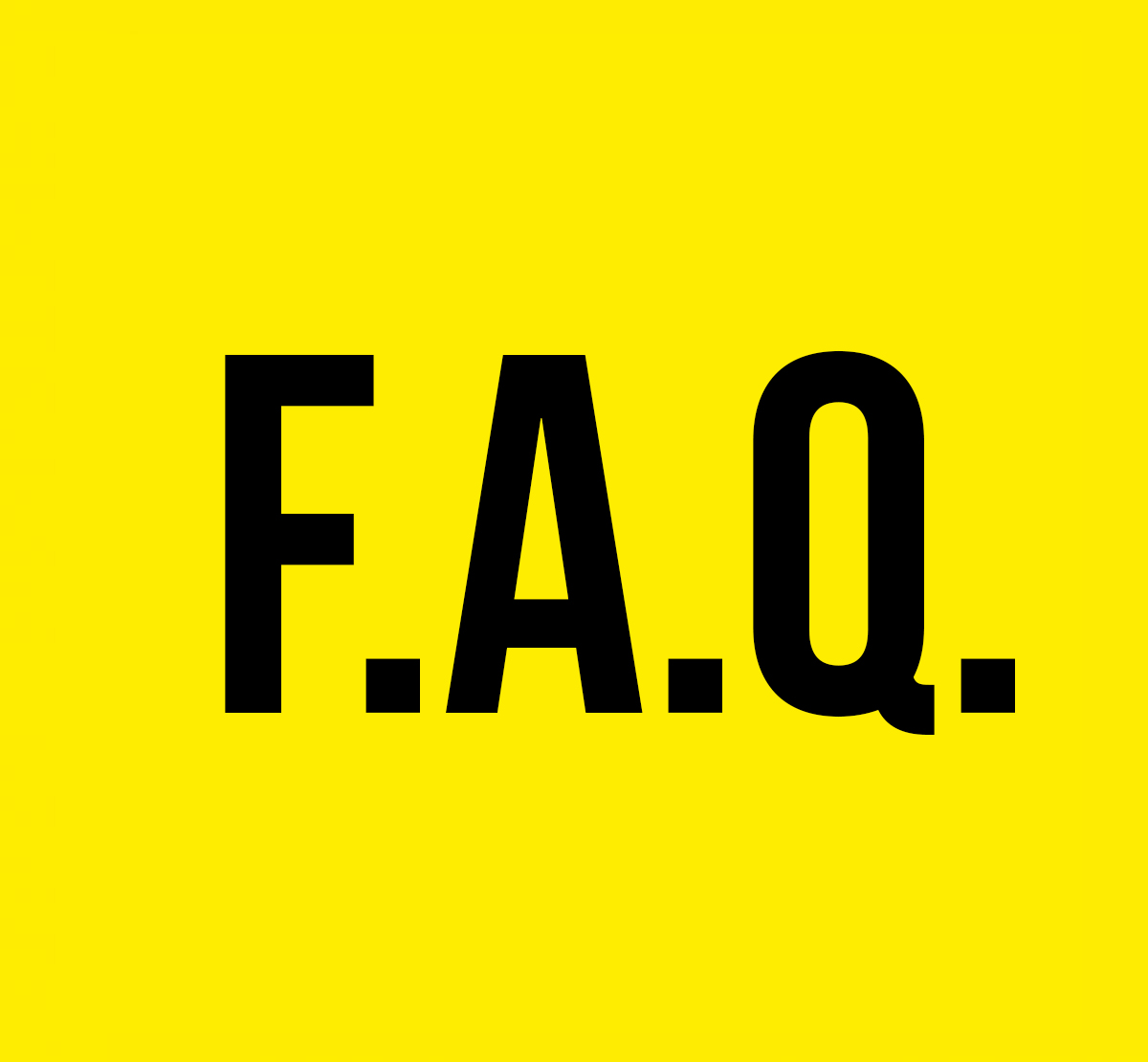

Publier un nouveau commentaire